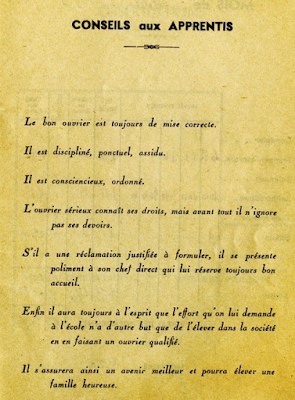47 ANS A POMPEY – MANOIR INDUSTRIES
Témoignage de Paul Grisel
Paul Grisel a travaillé de 1945 à 1992
dans l'usine du Manoir. Son témoignage est donc précieux pour la connaissance
de cette période, et nous le remercions de nous avoir permis sa publication.
1945-54
Après le certificat d'études, je
suis entré en juillet 1945 comme apprenti aux Forges et aciéries de Pompey,
usine du Manoir à Pîtres, à l'atelier
d'usinage, dans le local outillage : on
n’utilisait pas encore à l'époque les outils à pastille de carbure, et un
forgeron, M. Camus, forgeait sur place les outils des tours, étaux-limeurs,
raboteuses et mortaiseuses.
Au début, je me rendais d’Alizay à
l'usine à bicyclette, avec le vélo de mon frère Raymond, et par beau temps je
retournais chez moi le midi, mais par la suite c'était souvent la gamelle, en
aluminium rectangulaire, modèle 1940, avec son petit plat juste sous le
couvercle.
Le chef de l'atelier d'outillage
était Robert Duchaussoy et celui de l'atelier d'usinage M. Schnick.
Raymond Levif,
Robert Braun, le père Tesson, le père Renard, Marcel Riberprey, au tour vertical Louis Chaillot, aux
étaux-limeurs Raymond Vitis, René Fabulet, Agapit Terrey et son frère Robert, à
la fraiseuse René Delabove, sur la grosse raboteuse GSP Grémèse Attilio, dit le macaroni, forcément,
à l’ajustage Germain Lemaître et André Nodet, et un soudeur à l’arc que je
n’ai jamais connu que sous le nom de La
frite. Les contrôleurs-traceurs : Maurice Legand et le père Diéval dit le
vautour à cause de sa façon de marcher tête penchée. Schnick, le chef de
l'atelier d'usinage, comme beaucoup d'anciens à l’époque, venait de l'usine
mère en Lorraine, Pompey Dieulouard. Le chef du garage de l'entreprise à l'époque était M.
Diénis, déjà présent dans les années 40-44, sa position lui permettait de
rendre pas mal de services.
La colo
En tant que jeune apprenti ouvrier,
j'ai pu bénéficier de colonies de vacances en 1947, 48 et 49. Doussard en
Haute-Savoie, Véreux dans la Haute-Saône. Nous partions par le train de Pont de
l'Arche à Paris puis vers le point de
vacances, accompagné par un cadre de l'usine, M. Munier, ex-adjudant employé au
bureau de pointage et comptabilité, que nous estimions beaucoup. Nous partions
avec sac de couchage et couverture fournis par l'usine et retrouvions d'autres
jeunes apprentis du groupe Pompey, du
Loir et des bureaux de Nancy.
 |
de g. à dr.: Maurice Picataux, Robert
Degans, André Prédent, l'auteur, Paul Grisel, Charles Parent
|
À l'usine, j’étais entré comme apprenti, mais j'ai suivi les cours d'instruction générale, dispensés par M. Amélien, un instituteur du Manoir, le dessin industriel avec un responsable du bureau de dessin, M. Bollard, et pour les travaux pratiques d'ajustage, je ne suis arrivé au niveau que parce que à l'occasion d'une grève, le directeur de l'époque, M. Arnaud, constatant que j'étais avec les grévistes, décréta que je ferais mieux de travailler des pièces d'ajustage. C'est ainsi que j'ai pu être reçu au CAP d'ajusteur en 1952, à Évreux, après avoir été recalé en 1951. À noter que chaque fois j'ai été logé sur place, aux frais de l'usine pour les deux jours, à l'Hôtel ou Ecu de France.
La bricole, la perruque.
 |
| Petite enclume, fin années 40 |
Manger à l'usine le midi me permettait d'aller faire des échanges avec les prisonniers allemands au camp des Américains, ou de la récupération au parc à ferraille de l'usine, où l'on trouvait à peu près de tout : vieilles chignoles, vilebrequins, perceuses. C’était ce qu'on appelait la bricole ou encore la perruque. Les choses trop volumineuses ne pouvant être sorties dans la musette faisaient l'objet d'un bon de sortie avec ou sans facturation. C'est ainsi que je me suis fabriqué une chignole à plateau à deux vitesses et deux autres à carter. Cette façon de se faire des outils était un très bon apprentissage.
Certaines bricoles étaient faites en
cachette, d'autres avec l'accord du chef d'atelier. Lorsqu'il s'agissait de
débit de bois important, il fallait un bon de sortie, et le prix était retenu
sur la paye. Cela restait un réel avantage, qui a peu à peu disparu. Certains
ont même pu profiter d'un programme de réalisation de maisons individuelles en
fabriquant charpente et menuiserie à
l'usine.
J'ai aussi commencé la fabrication d'une
remorque pour bicyclette, restée sous mon établi quand je suis parti au service
militaire, et terminée en rentrant, de nombreux modèles réduits de Jeep et de
camions en aluminium moulé, une scie circulaire de table, une meule ….
Les "actions "
Les petits coups fourrés étaient fréquents
: graisse sur le manche du marteau, jets d'eau avec les seringues à huile, et
le pire qui me soit arrivé fut de me retrouver avec un vélo à guidon fixe et
une selle tournant dans tous les sens. On appelait cela une action.
Parfois c'était une tape amicale sur le visage, avec une main qui avait caressé
la poudre de graphite ou tout autre produit bien noir.
Pour tous, j'étais Popaul, le gamin, le
mousse, ou le bézot, un peu au service de tout le monde, avec une grande envie
de travailler sur les machines, mais je devais me contenter de réparer leurs
courroies de transmission : on en était encore à faire tourner presque toutes
ces machines avec un seul gros moteur, un arbre de transmission principale et
des courroies. Lorsqu'elles cassaient, il fallait les réparer, en rajoutant
souvent des longueurs, avec des agrafes. Le jour où, en manœuvrant le rhéostat
pour mettre en route le moteur, je fus brûlé par le petit arc électrique qui se
formait à chaque plot, on me dit « c'est le métier qui rentre » et on
m'envoya malgré tout voir la « mère » Épiphane au laboratoire, qui
faisait office d'infirmière, alors que son activité principale, c'était les
analyses des taux de carbone dans les aciers élaborés au four électrique, ce
qui à cette époque était encore assez nouveau, puisqu'auparavant les aciers
étaient élaborés aux fours Martin, qui ne disparurent qu'en 1957-58, avec la
grande cheminée à laquelle ils étaient raccordés.
Depuis cette époque, que de changements
dans l'entreprise, tant sur le plan des aménagements, du matériel de
surveillance des contrôles de qualité ! J'ai vécu tout cela, j'ai
participé d'une certaine façon, modeste peut-être, mais tous nous nous sentions
concernés par cette évolution et cette modernisation, même si parfois nous disions en avoir
ras-le-bol.
J'ai donc été amené à faire un peu de
tout, peindre au minium les pièces pour la société Coder, qui les voulait
peintes, installer des bardages sur les aérations du toit en tuile de la
fonderie, avec le charpentier couvreur de l'entreprise, M. Lefebvre, qui
travaillait au modelage en même temps que moi dans les années 50-52.
Les vacances étaient obligatoires, mais
nous n'étions pas obligés de les prendre, et je suis souvent resté ces trois
semaines par an à repeindre les chariots de transport de palettes. C'était le
début de la motorisation des déplacements de produits à l’intérieur des
ateliers.
Dans le même temps, entraient dans
l'entreprise mes frères, mes belles-sœurs, et Irène ma future épouse, si bien
qu’à un moment donné nous étions huit : 1 % du personnel. Mais il y avait aussi
d'autres familles : les Legand, Mansuy, Audam, Purolzac : le père travaillait à
l'usine, faisait embaucher son fils, et les filles allaient dans les bureaux.
Mon propre fils est entré en 1976, embauché par M. Blanluet, chef du personnel
de l'époque.
Les cadres
Des ingénieurs principaux de l'usine, j'en
ai vu défiler un certain nombre, et ceux de mes débuts étaient des figures de
l'époque. M. Cordier venait d'Alizay comme moi à bicyclette, sur un vieux clou
qu'un beau jour il me confia pour graisser le pédalier qui couinait. Un des
compagnons, toujours à l'affût d'un bon coup, me suggéra de démonter la selle
et de verser de l’huile dans le tube. Le lendemain, remarque gentille de
l'ingénieur qui me demanda de mettre un peu moins d’huile à l'avenir, car il en
avait une mare dans son garage…
M. Valette, responsable de la production
et du four à arc, venait du sud « avé l’accent » et disait souvent : « si on fout de la
merde dans le four, il n'en sortira que de la merde », pour expliquer
qu'il fallait sélectionner la qualité des ferrailles de récupération.
Il y avait aussi deux autres ingénieurs
étrangers, l'un allemand, M. Bohr, et l'autre autrichien, le père de Michel
Leeb.
Mon chef d'atelier habitait une petite
maison en bois dans le quartier des Hautes Loges et assez souvent, pendant plus
d'un an et demi, j'y allais en mission couper du bois, retourner le jardin, et
lui chercher du lait à la ferme. J'avais alors droit à un petit coup de café et
devais arriver à l'usine vers 7h45 au
plus tard.
L'ingénieur allemand fut à l'origine du
premier sigle des Aciéries du Manoir Pompey : AMP, que l'on appelait à l'époque
le hibou, marqué sur toutes les pièces, petites ou grosses, qui sortaient de
l’usine, et a depuis été remplacé par le M. et le I entrelacés de Manoir
Industries.
Il y avait aussi deux ingénieurs italiens,
Solente et Bassetti, qui mirent en place une nouvelle organisation de pointage
: un quart d'heure de retard donnait 0,25 % de pénalité sur la prime de fin
d'année, une journée sans autorisation 5 %, avec autorisation 1 %, etc.
Mon frère qui était entré à l'usine comme
pontonnier travaillait en équipe et comme nous couchions dans le même lit,
quand il était en retard, je l'entendais rouspéter et marmonner jusqu'à son
départ « les P chinq, les P chinq », en clair le risque de perdre 5 %
de sa prime.
L'atelier d'ébarbage était quelque chose
de particulier, il y avait bien une ou deux machines pour enlever le sable
autour ou à l'intérieur des pièces, les grenailleuses, mais le plus gros du
travail se faisait dehors, sous des hangars ou à ciel ouvert, je vois encore
ces grosses pièces manœuvrées avec la grue à vapeur du père Bruno sur un
immense tas de sable où les gars travaillaient parfois sans casques ni masques
ou avec un grand mouchoir en guise de protection.
Pour le découpage au chalumeau, il y avait
des bouteilles d'oxygène, mais le gaz d'acétylène était fourni par des petites
cuves contenant du carbure et de l'eau. L'expédition des pièces se faisait soit
par voie de chemin de fer, soit par le camion de l'usine et son chauffeur.
Du fait de la reconstruction de la France
après la guerre, la production était surtout axée sur la fabrication de pièces
pour la SNCF, boisseaux et tampons de wagons. Les semelles des boisseaux
étaient rabotées et percées de quatre trous de fixation. C'était un travail répétitif,
souvent payé aux pièces, que ce soit l'ébarbage ou l'usinage, et il a pu
arriver que l’on arrive à déclarer plus de pièces que la fonderie n'en avait
réellement coulées...
La qualité de l'acier et des pièces de
chemin de fer était ce qu'elle était, ce n'est que plus tard que des
améliorations purent être apportées. Pour sauver des semelles de boisseaux
ayant de magnifiques soufflures, on les rebouchait à la soudure, avec parfois en guise de soudure
du fil de fer de 4 ou 5 mm de diamètre, nous étions loin des électrodes
enrobées. Pour ce genre de pièces, on parlait communément de « fer à
bourriques ».
J'ai commencé à prendre conscience de la
qualité des aciers à l'époque où nous fabriquions des ressorts pour les
autocars Chausson Panhard. Me trouvant un jour dans un des bureaux de la
direction, j'y vis un représentant de cette société qui montrait une de ces
pièces qui n'avait pas résisté à un essai, à cause d'une soufflure, d'une
crique, ou des propriétés mécaniques du métal. En fait c'est avec l'arrivée de
Leeb que furent élaborées au Manoir différentes nuances d'acier avec la mise en
place de fours hautes fréquences.
La grue à vapeur du père Bruno se
déplaçait sur le pourtour et à l'intérieur du parc sur des rails écartement
SNCF puisque nous étions raccordés à la ligne Pont de l'Arche-Gisors, par laquelle arrivaient des wagons de ferraille,
de sable de moulage, de charbon pour les fours, de coke pour le chauffage des
poches de coulée ou le chauffage des bureaux et des braseros installés dans les ateliers.
 |
| Nous n'avons pas trouvé de photo de la grue en question, peut-être plus moderne que celle-ci |
La chaudière de la grue était alimentée avec des briques de charbon, comme les locomotives de chemin de fer et ses briquettes étaient stockées du côté de la centrale électrique, et à chaque arrivage, l'empilage était passé à la peinture blanche pour signaler les éventuels manques, car il arrivait que certaines nuits des briquettes se fassent la malle.
Les crasses des fours dégagés par la grue,
dans le prolongement de la fonderie, côté nord, formaient un crassier d'une
bonne hauteur.
Lors de l'allongement du bâtiment de la
fonderie et pour l'installation du chemin de roulement des ponts roulants, il
fallut dégager le crassier, ce qui fut réalisé avec bulldozer et niveleuse,
comme nous en avions vu à l'œuvre sur le camp américain entre Alizay et le
Manoir. C'était toujours pour nous un spectacle aux arrêts, casse-croûte ou
repas du midi que le va-et-vient de ces engins. Les crasses ont été
transportées dans une ancienne carrière de l'autre côté de la route entre
Pîtres et le Manoir.
Le manque de matériel de traction après la
guerre entraînait beaucoup de récupération : camions GMC ou Dodge 4x4 réformés
de l'armée. L'entreprise possédait un
camion benne dont le personnel pouvait disposer pendant le week-end s'il était
disponible. Nous pouvions également nous faire livrer divers matériaux qui
étaient facturés à l'entreprise et nous étaient ensuite revendus. De même
lorsque les déchets de bois de modelage en fin de semaine étaient intéressants,
nous pouvions avoir du bois de chauffage à bon marché. L’usine nous
approvisionnait aussi en pommes de terre, que nous achetions pour l'année,
parfois en vin. Il y avait aussi des distributions de pneus de bicyclette, de
chaînes à vélo, par longueur de 15 ou 20 m, que les gars de l'outillage
recoupaient.
1954 – 1986
Reprise du travail après mon retour
d'Algérie, sur un poste de réceptionniste au service contrôle, pour assurer le
suivi des éprouvettes pour les tests de qualité : traction, résilience, etc. ce
travail m'amenait à faire des déplacements à Rouen, mais j’ai préféré
réintégrer l'atelier de modelage métallique. J'y fis de nombreuses heures
supplémentaires, travail du samedi après-midi.
En 1957-58 l’ingénieur en chef de
l'époque, M. Hubert me donna un mois de remise à niveau, et petit à petit on
commença à me confier ce qui était nouveau sur le plan technique : mise en
route de nouvelles machines, ou fabrication de modèles en plastique, stratifiés
avec de la fibre de verre. J'étais toujours prêt. Si une nouvelle machine à
mouler ne fonctionnait pas correctement, je venais le samedi. C'est ainsi que
je gravis les échelons OP1, OP2, OP3.
Au chantier de modelage, les modifications
furent nombreuses et le modelage métal a déménagé au moins trois fois avant
l'incendie de 1965. Nous faisions très souvent tout nous-mêmes en partant du
plan : le pré-modèle en bois, ensuite en métal blanc, mélange de plomb et
d'antimoine, en bronze ou en aluminium et parfois en fonte.
Nous avions une petite forge d'atelier qui
nous servait à faire certains de nos outils : burins, tournevis et
autres, et sur cette forge nous faisions
les petites fusions jusqu'à 10 voire 15 kilos de métal, dans de petits creusets
en graphite. Pour les fusions plus importantes, nous utilisions un cubilot au
coke, qu'il fallait allumer avec du bois et entretenir pendant toute la durée
de la fusion. Lors de l'allumage, c'était souvent beaucoup de fumée, dont tout
le chantier profitait. Après l'incendie de 1965, un four à fioul est installé
avec une cuve d'occasion de plus de 3000 litres enterrée, mais qui a dû être
remplacée car elle fuyait. Pour réaliser nos moulages nous utilisions du sable
de Fontenay, silico-argileux très bien adapté, le problème étant qu’après les
coulées il fallait rebattre ce sable pour les prochains moulages, écraser les
mottes durcies, ajouter du sable neuf. J’ai proposé une amélioration qui
consistait à renvoyer le sable pour qu'il soit recyclé à la sablerie, ce qui
était un grand gain de temps.
 |
| Un moule |
C'est à cette époque que nous avons démarré à l'usine, à petite échelle d'abord, le moulage de précision en carapace. Les modèles étaient montés sur des plaques de fonte, adaptées sur des machines chauffées au gaz, et arrivées à une température de l'ordre de 130 à 250°, ces plaques étaient renversées sur un bac de sable pré-enrobé pendant 3 à 5 minutes selon l'épaisseur du sable que l'on voulait obtenir. Après plusieurs essais, j’ai soumis l’idée que pour certaines pièces, les modèles pouvaient être faits « nature » c'est-à-dire sans noyau, d'où une économie de réalisation tant pour le modelage que pour le moulage, et ce fut fait pour certaines pièces de guidage pour Babcock.
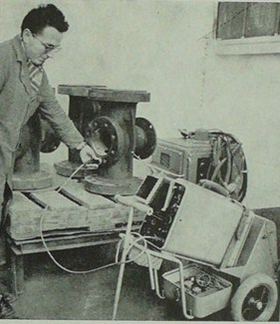 |
| Contrôle aux ultrasons |
Après l'incendie de 1965, suite à des travaux de soudure du service entretien au-dessus du local à peinture, un atelier neuf fut construit, bien clair, chauffé, avec aspiration des copeaux sous le niveau du sol. À part une des machines qui avait été récupérée, nous avons à nouveau réalisé des modèles neufs, en bronze autour de la fraiseuse, puis ce fut l'arrivée des machines à mouler les carapaces licence américaine.
1968
Nous avions pu entrer au travail un lundi
matin, sous les quolibets et les injures des grévistes, mais à 13h30 ce ne fut
plus possible. J'avais participé à des grèves dans le passé, plutôt par amitié
avec les copains, mais je n'avais jamais interdit à quiconque de travailler. En
1968, marié avec trois enfants je ne pouvais guère me permettre de perdre mon
salaire, les mensualités de la maison à payer en 20 ans étaient encore
importantes, et nos deux salaires venaient de l'usine.
À la fin de l'année, on me proposa un
poste de responsable du secteur chantier croning. Le responsable devait partir
à la retraite, le père la médaille, c'était son surnom, car il avait l'habitude
avant chaque coulée de sortir une médaille de sa poche et de la porter à ses
lèvres.
Le plus difficile était de trouver du
personnel, sur dix gars qui passaient, il en restait trois au maximum, par
manque de formation. Nous disposions de machines à mouler, supposées tenir une
cadence de 20 moules à l’heure, qui ne fut jamais atteinte, et l'on installa de
nouvelles machines à tirer les noyaux dont l'une avec un nouveau procédé dit
boîte froide.
En 1985, le chantier fut démonté pour être
expédié dans l'usine de Boulogne, ainsi que la sablerie.
En 1975, j’eus la main gauche prise dans
une machine, et de la chance de pouvoir conserver tous mes doigts, seule une
phalange ne répondant plus. Pendant les trois semaines d'arrêt de travail, je
continuais à aller au chantier, mais fus évidemment très blessé que l'ingénieur
principal me fasse des griefs concernant la production alors que je n'avais
même pas à être là.
Dans les années 50 à 60, alors que nous
mettions en route une grosse machine à noyau pour faire les godets de coulée et
que pour la circonstance je participais aux essais avec le PDG, Roger Hubert,
il m'avait dit, en parlant de la productivité de la machine : « c'est ça ou on
crève ». C'est avec lui que nous avons démarré la centrifugation des tubes.
En 1976, quelques mouvements de grève, des
défilés dans les ateliers, également en 1980. Une nuit, à l'usine, il y eut une
incursion des gars des piquets de grève, ouvriers noirs en tête, les gars de la
CGT restant en arrière, mais nous avons réussi à garder la place sans que cela
dégénère. En 1980, nous avons fait sortir des lots de pièces de l'usine et,
entre 4 et 6 heures du matin, sous protection policière et sous les huées des
piquets de grève.
 |
| Le repas annuel des anciens, jusqu'en 1994, rassemblait une centaine de personnes |
Ma vie professionnelle s'est arrêtée le 31 décembre 1991, 6 mois avant
mes 60 ans, et j'étais en retraite à compter du 1er juillet 1992.